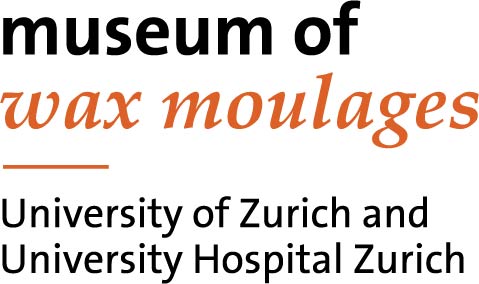Javascript templating
< BACK TO HOME
Musée des moulages, Hôpital Saint-Louis, AP-HP
Our project
Questions
The principles of modern research ethics mean that wax moulages can no longer be produced from patients as they were in the early twentieth century. But since old wax moulages provide a wealth of clinical information that is still relevant today, can these collections be reused for the purposes of contemporary medical education? This endeavour raises questions about how to convey the complexity of these historical objects, which lie somewhere between works of art and educational artefacts, and are direct witnesses to an era of medicine with a fascination for the sensational, and little apparent concern for human suffering.
Questions
Aujourd’hui, il n’est plus envisageable de réaliser des moulages en cire dans les mêmes conditions qu’au début du 20e siècle. Les règles déontologiques et éthiques qui encadrent la recherche menée sur des patients l’interdiraient. Dès lors, peut-on réutiliser les collections anciennes pour la pédagogie médicale contemporaine ? Les moulages en cire anciens sont en effet porteurs d’un riche enseignement clinique, encore pertinent aujourd’hui. Mais comment rendre compte de la complexité de ces objets du passé, qui sont à mi-chemin entre l’œuvre d’art et l’artefact pédagogique ? qui sont témoins directs d’une médecine fascinée par les cas spectaculaires et apparemment peu préoccupée par la souffrance humaine ?
Origin
Over the past few years, the Medical Humanities programme at the University of Geneva (UniGe) has been working on an educational initiative in close collaboration with the Geneva University Hospitals (HUG) Dermatology and Venereology department and the Geneva Musée d’Histoire des Sciences (MHS). Teaching sessions held at the MHS introduce medical students and trainees to its collection of wax moulages illustrating symptoms of syphilis, which are stored in humidity-controlled rooms. Due to their graphic nature, these moulages are not on public display in the family-friendly collections of the MHS.
The success of these teaching sessions gradually developed into a research interest in old moulages as objects of a material, technical and human history of medicine. We began working with the Moulagenmuseum in Zurich, which has the biggest collection of medical moulages in Switzerland, and with the Musée de l’Hôpital Saint-Louis in Paris, the world’s leading wax moulage museum. As part of our research project, we held a two-day workshop that brought together collection managers and specialists from Europe and North America to discuss the material, medical and cultural issues surrounding these objects. An in situ art installation held in conjunction with the workshop offered a fresh perspective on the particular site of the museum in Paris, the moulages and the symbolic presence of patients.
One of our goals was to produce high-definition 3D digitisations of old moulages, in order to make them available to interested clinician and historian colleagues. We presented an initial, partial version of these digital models at an international summer school focusing on ‘New Trends in Medical, Material, and Audiovisual History’. One of the key contributions came from medical anthropologists, who stressed the need not to simply provide digital reproductions of these old objects, but also to contextualise them and explain the ‘medical gaze’ behind them. This discussion has influenced the way in which this website is presented, urging us to explain our research approach and provide further insight into the moulages through interdisciplinary commentaries. For those who wish to explore this topic in more detail, a suggested reading list is provided below, to which we will gradually add publications from our own Neverending Infectious Diseases research group.
Genèse
Depuis plusieurs années, une collaboration pédagogique étroite existe entre le programme des Medical Humanities de l’Université de Genève (UniGe), le Service de dermatologie et vénérologie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), et le Musée d’histoire des sciences (MHS) de Genève. À l’occasion de cours donnés au MHS, les étudiants en médecine ou les internes hospitaliers découvrent la collection de moulages syphilitiques en cire conservés dans des pièces à hygrométrie contrôlée. Étant donné le caractère impressionnant des lésions qu’ils présentent, ces moulages ne sont pas exposés dans les vitrines d’un musée familial tel que le MHS.
Le succès de ces cours s’est progressivement transformé en intérêt de recherche pour les moulages anciens, en tant qu’objets d’une histoire matérielle, technique et humaine de la médecine. Nous avons commencé à travailler avec le Moulagenmuseum de Zürich, qui possède les plus grandes collections de céroplasties pathologiques en Suisse, et avec le Musée de l’Hôpital Saint-Louis de Paris. Ce dernier reste la référence internationale en matière de moulages en cire. Dans le cadre de notre projet de recherche, nous y avons organisé un workshop de deux jours [hyperlink], réunissant des responsables de collections et des spécialistes venant d’Europe et d’Amérique du Nord. La réflexion a porté sur les enjeux matériels, médicaux et culturels de ces pièces. En parallèle, une installation artistique in situ [hyperlink] proposait un regard renouvelé sur ce lieu particulier, sur les moulages et sur la présence symbolique des malades.
L’une de nos ambitions était de produire des digitalisations 3D en haute définition de moulages anciens, afin de les mettre à disposition des collègues cliniciens et historiens intéressés. Une première mouture, partielle, de ces digitalisations a été présenté lors d’une summer school internationale que nous avons spécifiquement consacrée aux New Trends in Medical, Material, and Audiovisual History [hyperlink]. L’un des apports majeurs est venu des anthropologues de la santé, qui ont insisté sur la nécessité de ne pas simplement reproduire numériquement les pièces anciennes, mais de les contextualiser, d’expliciter le medical gaze à l’origine de ces pièces. Cette discussion a influencé la présentation du présent site web, avec la volonté d’expliquer notre démarche de recherche et d’éclairer les moulages par différents commentaires disciplinaires. Pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet, nous suggérons ci-dessous quelques références bibliographiques, qui sont progressivement alimentées par des publications de notre propre groupe de recherche sur Neverending infectious diseases.
Status
Medical wax moulages have an ambiguous status, somewhere between works of art and educational artefacts. This ambiguity is reflected in the classification of these objects, which are sometimes held in art and historical collections, and sometimes in university medical collections. Irrespective of how they are classified, it is important to recall that despite their striking realism, moulages are not human remains in the same way as objects such as skulls, histology slides, biological specimens preserved in paraffin or whole organs in formalin.
But wax moulages do, however, retain the imprint – in the truest sense of the word – of past pain. To make a moulage, the modeller would have a patient brought in, usually on the orders of a dermatology professor. They would cover the patient’s open sores with an intestinal membrane, then apply coats of plaster to create the negative mould. If the lesions were on the face, straws were inserted into the nostrils to enable the patient to breathe while the plaster set. The pain of the skin lesions was compounded by that of the negative imprint. The hospitalised patients used to produce moulages were often what we would now term vulnerable patients, and obtaining their consent was of little concern.
The shift from a wax moulage to its digital scan does not, therefore, simply involve an object, but also a past doctor-patient relationship, a point of view specific to early twentieth-century medicine, a set of professional values and, finally, the silence of the patients with syphilis used to make these moulages.
Status
Les moulages pathologiques en cire possèdent un statut ambivalent, entre l’œuvre d’art et l’artefact pédagogique. Cette ambivalence se retrouve dans la classification de ces pièces qui, d’un lieu de conservation à l’autre, relèvent de collections patrimoniales ou alors de collections médico-universitaires. Mais dans les deux cas, il faut rappeler que les moulages, malgré leur réalisme saisissant, ne sont pas des restes humains au même titre que, par exemple, des crânes, des lames histologiques, des échantillons biologiques conservés dans la paraffine ou des organes entiers dans le formol.
Néanmoins, les moulages en cire conservent l’empreinte – au sens propre – de douleurs passées. En effet, pour réaliser un moulage, le céroplasticien faisait venir un patient, généralement sur ordre d’un professeur de dermatologie. Il appliquait alors une membrane viscérale sur la lésion à vif, puis l’enduisait de plâtre pour créer le moule négatif. Si la lésion se trouvait sur le visage, des canules de paille introduites dans les narines devaient permettre au patient de respirer le temps que le plâtre prenne. La douleur du moule négatif s’ajoutait à celle des lésions dermatologiques. Souvent, les patients hospitaliers moulés relevaient de ce qu’aujourd’hui on nommerait des patients vulnérables, et l’obtention de leur consentement restait secondaire.
Par conséquent, lors du passage de la céroplastie à sa version numérisée, nous apportons à nous bien plus qu’un objet : un état passé des relations entre médecins et patients, un point de vue propre à la médecine du début du 20e siècle, un ensemble de valeurs professionnelles, enfin le silence des patients syphilitiques moulés.
Approach
Questions have been asked about whether our digital museum requires ethical approval. But moulages do not come under the scope of the ethics committees available to us: neither clinical ethics nor human research ethics are equipped to rule on this case. More fundamentally, getting the green light from an ethics committee would not advance our understanding of the issues raised by these objects. Obtaining ethical approval could in fact be seen as an easy way of avoiding a proper discussion about the historical conditions in which moulages were produced, their scientific and cultural status and the acceptability of their contemporary reuse in the form of 3D scans. We believe that the most honest way forward is therefore to provide critical contextualisation alongside our act of making these moulages available to the clinical and research community.
We note, however, that this contextualisation, which takes the form of commentaries accompanying each moulage, is limited. The main reason for this is that the original objects were not linked to paper records or, as far as we know, these links have been lost. It is therefore impossible to trace the individual stories of the patients whose bodies were used as models for the moulages.
Démarche
La question s’est posée de savoir si notre musée digital devait obtenir un blanc-seing éthique. Mais les moulages ne relèvent pas des commissions d’éthique dont nous disposons : ni l’éthique clinique ni l’éthique de la recherche sur l’être humain ne sont qualifiées pour se prononcer en l’occurrence. Plus fondamentalement, le feu vert d’une commission d’éthique n’aiderait en rien à mieux saisir les enjeux liés à ces pièces. Obtenir une garantie éthique constituerait même une manière facile de se décharger d’une véritable réflexion sur les conditions historiques de production des cires, sur leur statut scientifique et culturel, sur l’acceptabilité de leur réemploi contemporain sous forme de scans 3D. La manière la plus honnête de procéder consiste donc à accompagner le fait de remettre des moulages à disposition de la communauté des cliniciens et des chercheurs par un geste de contextualisation critique.
Il faut néanmoins relever que cette contextualisation, qui prend ici la forme de commentaires attachés à chaque moulage, est limitée. La principale raison est que les pièces originales ne sont pas liées à des documents papier ou que, à notre connaissance, le lien à des documents papiers est perdu. Il est donc impossible de retrouver les trajectoires individuelles des personnes malades dont les corps ont servi de modèles pour les moulages.
Digitisation
The process of 3D digitisation restores the astonishing contemporary clinical relevance of old moulages for medical students and clinician researchers. It also offers a number of practical benefits, including the ability to make ‘backups’ of the rarest or most fragile original objects. Users can manipulate the digital moulages in 360°, annotate them, zoom in on details, export them in different formats and share them. The high resolution of the models, combined with lightweight 3D graphics suitable for viewing on smartphones, enables these objects to be used as teaching aids in parts of the world with no access to conventional museum collections.
It is important to recall, however, that just as the moulage is not the patient, the 3D scan is not the moulage. These 3D digitisations are essentially digital interpretations of the original moulages. Their colours are altered by the type of screen they are viewed on. They vary in size. They have no weight. They are shown against a neutral background. Selecting the right technical settings for the meshing and photogrammetry of the 3D scans has been an integral part of the research process. And despite our painstaking endeavours, the 3D modelling of certain parts, such as the hair and eyebrows, sometimes remains unsatisfactory. We had to call on a digital texturing expert to help us restore the naturalness of some of the original moulages, with some additional digital artifice.
But the biggest difference between the originals and their digital reproductions is perhaps where they are exhibited. While you can view a 3D model on your own, anytime and anywhere, to see the original moulages you typically have to go to a dedicated venue that is open at specific times, and where these objects are commented on by a small group of professionals, or in a teaching session with multiple participants. This shift from a closed exhibition space, frequented by specialists, to a space that is potentially open to everyone – the internet – can be problematic. The circulation of the objects is not in itself an issue: they were in fact intended to be passed from hand to hand, as clearly shown in the venereal disease prevention films of the first half of the twentieth century. But there is a danger of this shift changing the way we look at moulages, turning them from objects of specialist knowledge into objects of sensationalist spectacle. This debate is not a new one: throughout the nineteenth and twentieth centuries, wax moulages were displayed at fairs and in various lurid exhibitions, blurring the lines of their status.
The approach we have taken here is not to censor these moulages, but to present them in a professional context, with a critical perspective, and with explanatory framing such as the text you have just read.
Digitalisation
La digitalisation 3D réactive l’étonnante pertinence clinique contemporaine des moulages anciens auprès des étudiants en médecine et des cliniciens-chercheurs. De plus, elle présente différents avantages pratiques, dont la “copie sauvegarde” des pièces originales les plus rares ou les plus fragiles. Elle offre la possibilité pédagogique de manipuler les moulages à 360°, de les annoter, de zoomer sur des détails, de les exporter sous différents formats et de les partager. La haute résolution alliée à des modèles 3D légers adaptés à la consultation sur smartphones, permet aussi de proposer ces pièces pour l’enseignement dans des régions du monde où l’accès aux réserves d’un musée est impossible.
Pour autant, il faut garder à l’esprit que, de même que le moulage n’est pas le patient, le scan 3D n’est pas le moulage. Les digitalisations 3D sont avant tout des interprétations numériques des modèles originaux. Leurs couleurs sont changeantes selon le type d’écran sur lequel on les visionne. Leur taille varie. Ils n’ont pas de poids. Ils apparaissent sur un fond neutre. Le bon réglage des paramètres techniques du maillage et de la photogrammétrie nécessaires aux scans 3D font d’ailleurs partie intégrante du processus de recherche. Et malgré tout le soin apporté, le rendu 3D de certaines parties telles que les cheveux, les poils et les sourcils, reste parfois insatisfaisant. Nous avons dû faire appel à une spécialiste du texturing digital afin de restituer, par un surplus d’artifice numérique, le naturel de certains modèles originaux.
Mais la principale différence entre l’original et sa reproduction numérique tient probablement dans le lieu de leur exhibition. On peut visionner un modèle 3D seul, n’importe quand et n’importe où. Au contraire, pour les modèles originaux, il faut généralement se déplacer dans un lieu dédié, selon des horaires imposés, et les modèles sont commentés dans le cadre d’un cénacle professionnel ou d’un enseignement réunissant plusieurs personnes. Ce passage d’un lieu d’exposition fermé, fréquenté par des spécialistes, à un lieu – Internet – potentiellement ouvert à tout le monde, peut être problématique. Ce n’est pas en soi la circulation des pièces qui est problématique : leur passage de main en main était même une de leurs raisons d’être, comme on le voit bien dans les films de propagande antivénérienne de la première moitié du 20e siècle. Le problème, c’est que ce passage peut modifier les conditions du regard posé sur les moulages : d’objets de connaissance spécialisée, ils peuvent devenir objets de spectacle sensationnaliste. Là aussi, le débat est ancien. La présence tout au long des 19e et 20e siècles de pièces céroplastiques sur les champs de foire et dans différentes expositions à scandale ont brouillé le statut exact des moulages.
Notre parti-pris consiste ici à ne pas censurer ces moulages, mais à les présenter dans un contexte professionnel, à travers un point de vue critique, et moyennant des seuils explicatifs comme le texte que vous venez de lire.
Bibliography
- Bonah Christian, Danet Joël, “D'après nature” (12’), MedFilm, 2022 ; Link (part of the Neverending project)
- De Chadarevian Soraya, Hopwood Nick (Eds), Models. The Third dimension of science, Stanford, Stanford U. Press, 2004.
- Delpeux Sophie, original de HDR, à paraître (part of the Neverending project)
- Doll Sara, Widulin Navena (Hrsg.), Spiegel der Wirklichkeit. Anatomische und Dermatologiseche Modelle der Heidelberger Anatomie, Berlin, Springer, 2019.
- Fend Merchtild, “Images made by contagion: on dermatological wax moulages”, Body & Society, Vol. 28, Issue 1-2 (Special Issue: Symmetries of Touch: Reconsidering Tactility in the Age of Ubiquitous Computing) March 2022, pp. 24-59; Link.
- Pierce Kathleen, “Photograph as Skin, Skin as Wax: Indexicality and the Visualisation of Syphilis in Fin-de-Siècle France,” Medical History 64, no. 1 (2020): 116-141; Link.
- Schnalke Thomas, Diseases in Wax. The History of the medical Moulage, Erlangen, Quintessence Publishing, 1995.
- Talairach-Vielmas Laurence (dir.), Histoire, médecine et santé, 5 (Special Issue Anatomical Models), spring 2014 ; Link.
- Wenger Alexandre (dir.), “Medico-pathological wax casts : objects of art, knowledge and teaching (late 19th-21st century)”, Histoire, Médecine et santé, Special Issue: forthcoming (part of the Neverending project)
- Wenger Alexandre, “Revisiting clinical knowledge through medical artefacts”, Re:visit 1 (2022); Link (part of the Neverending project)
< BACK TO HOME
TEAM AND PARTNERS
Conservatrice et restauratrice, Moulagenmuseum, Zürich
JULIEN DA COSTA
Design et développement web, Sketchnote 3D, Université de Genève.
STÉPHANE FISCHER
Assistant conservateur, Musée d’Histoire des Sciences de Genève
MICHAEL GEIGES
Dermatologiste, directeur du Moulagenmuseum, Zürich
Anatomiste et neurobiologiste, Responsable Sketchnote 3D, Université de Genève.
LAURENCE-ISALINE STAHL-GRETSCH
Responsable du Musée d’Histoire des Sciences de Genève
LAURENCE TOUTOUS-TRELLU
Dermato-vénérologue, Hôpitaux Universitaires de Genève
ALEXANDRE WENGER
Responsable projet, Medical Humanities, Université de Genève.
SPONSORS AND PROVIDERS